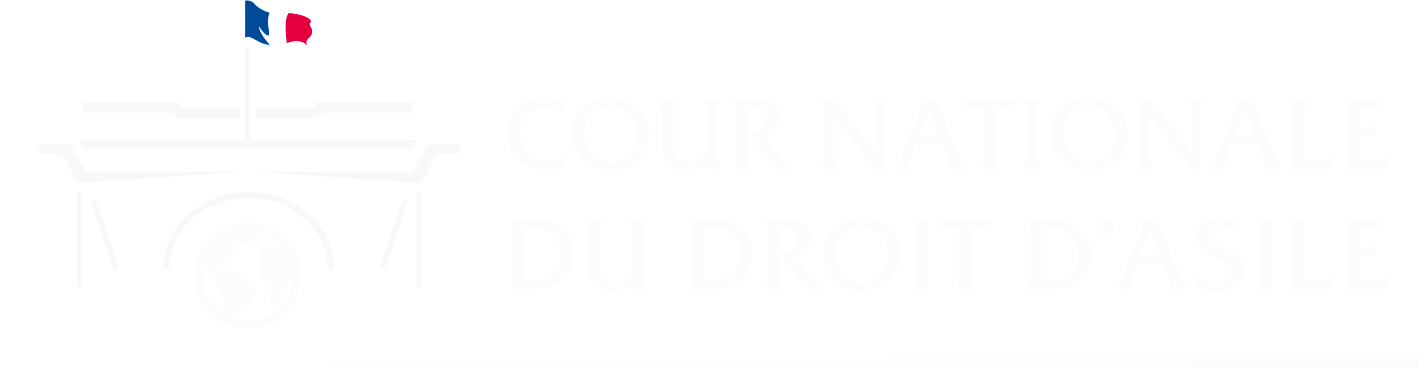Par son arrêt du 16 janvier 2024, WS (C-621/21), la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’en fonction des conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif de la persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié en application de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, tant les femmes de ce pays dans leur ensemble que des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire
Il faut pour cela qu’elles soient perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une identité propre dans cette société, en raison notamment de normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine.
Par des décisions nos 24014128, 24024165 et 24015934 en date des 11 juillet 2024, 3 avril 2025 et 16 octobre 2025, la CNDA a jugé que les femmes constituaient, dans leur ensemble, un groupe social en Afghanistan, en Iran et en Somalie.
Par une décision n° 23061821 rendue le 16 octobre 2025 en grande formation, la CNDA juge qu’eu égard à l’ensemble de normes de droit international et de droit interne adoptées par des institutions élues, mises en œuvre notamment par la première ministre et la ministre du « genre, famille et enfants » et qui traduisent l’évolution des normes sociales aussi bien que morales de la société congolaise, les phénomènes de discrimination et de violence qui perdurent à l’encontre des femmes en République démocratique du Congo ne peuvent s’analyser comme l’expression de telles normes sociales, morales ou juridiques traduisant une manière différente de percevoir les femmes par la société environnante mais, au contraire, comme des pratiques désormais réprouvées par cette société considérée dans son ensemble. Dans ces conditions, les femmes congolaises ne peuvent, dans leur ensemble, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social ».
La CNDA juge également que les femmes congolaises isolées, mères célibataires ou sans soutien masculin ne peuvent pas non plus être regardées comme appartenant à un groupe plus restreint de femmes, ces types de situations ne correspondant notamment pas à une « histoire commune qui ne peut être modifiée ». La seule circonstance d’être vulnérable et mère isolée n’expose pas davantage, par elle-même, à un risque réel de subir l'une des atteintes graves mentionnées à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier des traitements inhumains ou dégradants.
La Cour reconnaît en revanche l’existence d’un groupe social des enfants congolais accusés de sorcellerie qui partagent, même devenus adultes, une histoire commune qui ne peut être modifiée, notamment une situation familiale particulière, et dont les traitements discriminatoires, les pratiques d'exclusion et les stigmatisations, qui les affectent de manière générale, ont pour effet de les placer en marge de la société environnante.
La Cour rappelle cependant la nécessité d’un examen individuel, au cas par cas, du bien-fondé des craintes énoncées du fait de l’appartenance à ce groupe social. Il importe à cet égard d’examiner si le demandeur d’asile est perçu comme étant différent non seulement par les membres de sa famille et ses proches, mais également par la société environnante dans son ensemble.
CNDA 16 octobre 2025 Mme N, n° 23061821, R
Contacts presse : relation.presse@cnda.juradm.fr