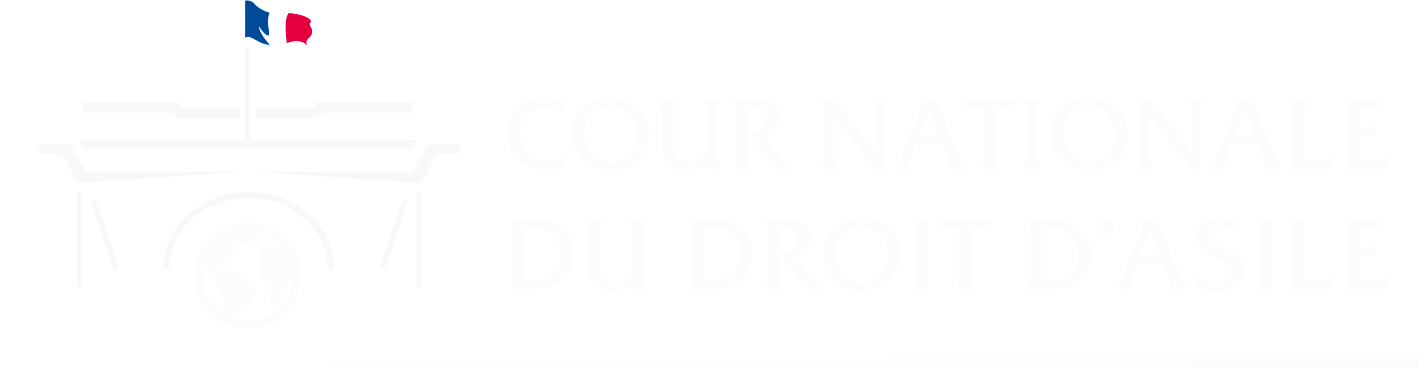Cette affaire concerne un ressortissant mauritanien reconnu réfugié en 1991, professeur de Coran et d'arabe classique auprès d'enfants dans le cadre de cours collectifs, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, commis de 1997 à 2000, et d’agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime, commis en 2010. Par un arrêt de juin 2020, la cour d’appel de Rouen a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions pénales. Par une décision du 6 juillet 2023, l’OFPRA a décidé de cesser de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, en application de l'article 1er, C, 5 de la convention de Genève et des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 511-8 du CESEDA, en estimant que les circonstances à la suite desquelles il avait été reconnu réfugié avaient cessé d’exister. Pour caractériser ce changement de circonstances, l’Office s’est fondé sur le fait que, depuis la fin des années 90, un mouvement de retour en Mauritanie des Négro-mauritaniens déportés avait été impulsé et qu’un programme d’insertion par le gouvernement mauritanien et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés avait été mis en place afin d'inciter et faciliter ce retour et l'intégration de ces populations au sein de la société mauritanienne. Par cette décision classée, la CNDA considère au contraire que la situation n’a pas connu, en Mauritanie, de modifications suffisamment significatives et durables pour que les motifs de craintes sur le fondement desquels la qualité de réfugié avait été reconnue à M. B. puissent être regardés comme ayant cessé d’exister. Pour estimer que les membres de la communauté négro-mauritanienne font toujours l’objet de discrimination généralisée et systémique, la Cour s’est fondée sur des sources fiables, récentes et publiquement disponibles. Puis, la Cour a examiné l’hypothèse d’une application du 2° de l’article L. 511-7 en raison de la condamnation en France de M. B., après avoir dument informé ce dernier qu’elle était susceptible d’envisager une telle application, au demeurant déjà soulevée par l’Office. Il est rappelé que la possibilité de mettre fin au statut de réfugié, sans incidence sur le fait que l’intéressé conserve la qualité de réfugié dès lors qu’il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives, la première étant que l’intéressé a bien fait l’objet de l’une des condamnations visées par le CESEDA, la seconde étant que la menace grave pour la société doit pouvoir affecter un intérêt fondamental de la société française, compte tenu non seulement des infractions pénales précédemment commises et des circonstances dans lesquelles elles l’ont été, mais aussi du temps qui s’est écoulé et de l’ensemble du comportement de l’intéressé depuis la commission de ces infractions ainsi que de toute autre circonstance pertinente. Ces dispositions de l’article L. 511-7, 2° du CESEDA transposent le b) du point 4 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, qui permet le refus ou le retrait du statut de réfugié « lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre ». S’agissant de la première condition d’application de l’article L. 511-7, 2°, précisément du quantum de la peine correctionnelle prévue par ces dispositions, la Cour se fonde sur les dispositions pénales applicables à la date de sa propre décision et non sur le texte en vigueur à la date des faits incriminés. En effet, si l’intéressé a été condamné au pénal sur le fondement du texte en vigueur au moment de la commission des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, lequel disposait qu’ils étaient punissables de 7 ans d’emprisonnement, le quantum de la peine encourue pour ces mêmes faits s’élève désormais, depuis la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. La décision relève que le quantum de la peine actuellement prévue permet de caractériser la particulière gravité du délit dont le requérant s’est rendu coupable au sens de l’Article 14-4 b) de la directive précitée. S’agissant de la seconde condition d’application de l’article L. 511-7, 2°, pour estimer que la menace grave que l’intéressé constituait pour la société française n’avait pas disparu, la Cour a pris en compte la répétition des faits durant une longue période, alliée à une absence de prise de conscience de leur gravité, ainsi qu’en témoignent les déclarations dénégatrices et versatiles de M. B., malgré le suivi socio-judiciaire avec injonction de soin dont il a bénéficié pendant cinq ans. CNDA 16 juillet 2025 M. B. n° 23045701 C+ .